Nous remercions James Rachels pour l’autorisation de traduire et de publier le présent article, paru sous le titre « Darwin, Species and Morality » dans The Monist, vol. 70 (1987) n°1.
I
« L'homme dans son arrogance se croit une grande œuvre digne de l'intervention d'un dieu. Il est plus humble et je pense plus vrai de le considérer comme créé à partir des animaux [1]. » Ainsi écrivait Darwin dans ses carnets de 1838, vingt et un ans avant la parution de son Origine des espèces. Il allait par la suite, on le sait, poursuivre cette idée en l'étayant d'une masse impressionnante de données, et il est courant d'entendre dire qu'il provoqua de ce fait un changement profond dans la conception que nous avons de nous-mêmes. Après Darwin, nous ne pouvons plus nous voir comme occupant une place spéciale dans la création - il nous faut au lieu de cela prendre conscience de ce que nous sommes le produit des mêmes forces qui, comme nous l'apprend la théorie de l'évolution, façonnèrent le reste du règne animal. Nous ne sommes pas une grande œuvre. Nous avons été créés à partir des animaux. Et ceci, dit-on, a des implications philosophiques profondes.
Bizarrement pourtant, ce ne sont pas les philosophes qui tiennent ce genre de discours. Les anthropologues, les journalistes et les poètes peuvent bien de leur côté penser qu'il y a une grande leçon philosophique à tirer des idées de Darwin ; mais, dans l'ensemble, les philosophes, eux, n'ont pas été de cet avis. Si nous examinons les œuvres philosophiques les plus influentes de ce siècle, nous n'y trouvons que peu de discussions sur Darwin et le darwinisme ; et quand malgré tout le sujet est abordé, c'est le plus souvent pour expliquer que le darwinisme n'a pas telle ou telle conséquence philosophique qu'on lui attribue souvent. Les philosophes semblent s'accorder pour dire comme Wittgenstein : « La théorie darwiniste n'a pas plus de rapport avec la philosophie que n'importe quelle autre hypothèse des sciences de la nature [2]. »
Pourquoi une telle indifférence envers Darwin de la part des philosophes ? Parmi ceux qui traitent de philosophie morale, il peut s'agir en partie d'une réaction à l'encontre de certaines affirmations exagérées qui furent faites tout d'abord. Quand lut L'origine des espèces la première fois, Karl Marx déclara : « Le livre de Darwin est très important et me sert de base pour la sélection naturelle de la lutte des classes dans l'histoire [3]. » Ultérieurement, d'autres socialistes devaient faire des déclarations semblables, affirmant souvent trouver dans le darwinisme la « base scientifique » de leurs idées politiques. Pendant ce temps, les capitalistes eux aussi s'annexaient Darwin : l'idée de la « survie du plus apte » revint comme un leitmotiv pour justifier les systèmes économiques basés sur la compétition [4]. On conçoit qu'une exaspération face à ce genre de sottises puisse fort bien provoquer des réactions semblables à celle de Wittgenstein.
Il y a une autre raison, plus générale, au scepticisme concernant la possibilité de tirer des conclusions philosophiques du darwinisme. Il s'agit du problème classique de la relation entre les faits et les valeurs, entre être et devoir. La théorie darwinienne nous dit, si elle est juste, ce qu'il en est de l'évolution des espèces et donc, en toute rigueur, on ne peut en tirer aucune conclusion sur une quelconque question de valeur. Il ne découle pas du fait que nous descendons des singes que nous devrions baisser dans notre propre estime, ou que nos vies ont moins d'importance, ou que les humains sont « seulement » une sorte d'animal parmi d'autres. Il n'en découle pas non plus que les dogmes fondamentaux de la religion soient erronés. Comme on l'a souvent fait observer, la sélection naturelle pourrait être le moyen choisi par Dieu pour créer l'homme. Dans ce cas, ce dernier pourrait continuer à être vu comme le couronnement de la création béni de Dieu.
On ne parvient pourtant pas à dissiper l'impression que le darwinisme a bien des conséquences déstabilisantes. Le sentiment que la découverte de Darwin sape la religion traditionnelle et aussi certains éléments de la morale traditionnelle ne se laisse pas chasser, malgré les fins arguments logiques sur quoi découle de quoi. Je pense que ce sentiment est justifié. Il y a bien un lien entre la théorie de Darwin et ces questions plus vastes, mais ce lien est plus subtil qu'une implication logique directe. Darwin lui-même avait bien vu cela. En 1880, deux ans avant sa mort, il écrivait (avec quelque raison selon moi) :
Bien que je sois un fervent défenseur de la liberté de pensée sur tous les sujets, il me semble (à tort ou à raison) que les arguments directs à l'encontre du christianisme et du théisme sont pratiquement sans effet sur le public et que le meilleur moyen de promouvoir la liberté de pensée est l'illumination progressive de l'esprit des hommes, laquelle résulte de l'avancement de la science. Je me suis par conséquent toujours efforcé d'éviter d'écrire au sujet de la religion et je me suis confiné à la science [5].
Ainsi, même si sa théorie ne constituait pas un « argument direct » à l'encontre du christianisme et du théisme, Darwin ne la voyait pas moins comme destinée à exercer une nette influence à long terme sur ces croyances.
L'idée que le darwinisme sape la religion est, bien sûr, familière, bien qu'il ne soit aucunement évident de dire en quoi il le fait. Je ne discuterai pas ici de la relation entre darwinisme et religion [*]. Je porterai plutôt mon attention sur une autre idée, moins bien explorée : que le darwinisme sape aussi certains aspects de la morale traditionnelle. Celle-ci repose, de façon cruciale, sur l'hypothèse selon laquelle il y aurait quelque chose de moralement spécial dans le fait d'être humain. Selon la morale traditionnelle, le fait qu'un être soit humain plutôt que, par exemple, bovin ou canin, implique une grosse différence quant à la manière dont on doit le traiter. Ma thèse est que « l'illumination progressive de l'esprit des hommes », telle qu'elle peut résulter de la théorie darwinienne, doit inévitablement conduire à la conclusion que cette hypothèse est fausse.
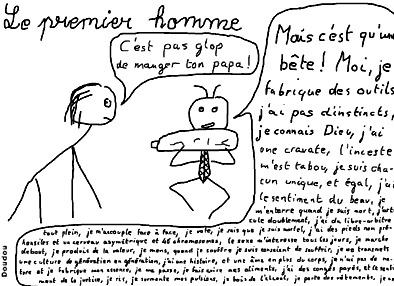
II
Lorsqu'il écrivit L'origine des espèces, Darwin prit grand soin d'éviter la question d'une éventuelle évolution des humains. La résistance à l'idée qu'une espèce quelconque puisse se transformer en une autre était déjà suffisamment forte, et il ne voulait pas compliquer inutilement les choses par l'évocation du problème émotionnellement chargé de l'origine des humains. Il n'en émit pas moins un avertissement. Tout à la fin de son livre, après avoir discuté pendant 450 pages de ce qu'il en est de dizaines d'autres espèces, Darwin fit la prédiction que, du fait de ses investigations, « beaucoup de lumière [serait] jetée sur l'origine de l'homme et sur son histoire [6] ».
Cette lumière devait venir dans deux ouvrages ultérieurs, La Descendance de l'homme (1871) et L'Expression des émotions chez l'homme et chez les animaux (1872) dans lesquels Darwin posait la question particulière de l'origine des humains. Il était convaincu, bien sûr, que l'homme est gouverné par les mêmes lois que le reste de la nature, et que nous-mêmes, comme les autres animaux, descendons de formes de vie plus primitives. Cependant, les données les plus impressionnantes en faveur de cette thèse - à savoir les restes fossiles des hominidés précoces - n'avaient pas encore été découvertes. Par conséquent, Darwin était obligé d'argumenter cette conclusion de façon indirecte, en mettant l'accent sur les ressemblances entre les humains et les autres animaux. Nous leur ressemblons tant, disait-il, que si eux sont le fruit de l'évolution, il n'est que raisonnable de penser que nous le sommes aussi.
Quelles étaient ces ressemblances ? Tout d'abord, l'homme, comme les autres animaux, est sujet à de petites variations individuelles (deux individus ne sont jamais tout à fait identiques), et celles-ci peuvent se transmettre par hérédité. Les hommes eux aussi se reproduisent en plus grand nombre qu'il ne peut en survivre. Du point de vue de Darwin, ces faits constituent à eux seuls des arguments décisifs, car ce sont eux qui permettent à la sélection naturelle d'opérer. Mais il y plus. Toute espèce possédant une large répartition aura tendance à se diversifier ; des variétés individualisées et géographiquement séparées apparaîtront. Et c'est ce qui se produit chez l'homme : les Africains, les Eskimos et les Japonais sont, pour l'œil exercé du biologiste, des formes variétales distinctes. De plus, comme l'ont toujours su les biologistes, il est facile de donner sa place à l'homme dans le grand schéma classificatoire : c'est un primate, un mammifère, et ainsi de suite. Dès lors que ces classifications sont conçues comme étant en relation avec des lignées évolutives, il est clair que l'homme lui aussi appartient à une lignée particulière.
Darwin était cependant conscient de ce que ce genre de données ne suffirait pas à convaincre les sceptiques. Depuis des temps reculés l'homme s'est cru spécial à cause de ses capacités intellectuelles supérieures. L'homme est l'animal rationnel. Et cela, comment pouvait-on l'expliquer sur la base de l'évolution ? Même certains évolutionnistes, tel Alfred Russel Wallace, estimaient cela impossible. Wallace, qui avait lui aussi formulé la théorie de la sélection naturelle indépendamment de Darwin, soutenait qu'elle ne s'appliquait pas aux humains. Darwin n'était pas de cet avis, et il chercha à expliquer même les plus prestigieuses caractéristiques humaines comme étant les produits de la sélection naturelle.
Qu'est-ce qui fait que l'homme est rationnel ? Une réponse fréquemment donnée est : sa capacité linguistique. Parce que nous maîtrisons un langage complexe, nous pouvons formuler des pensées, mener des inférences, et en général comprendre de manière sophistiquée à la fois nous-mêmes et ce qui se passe autour de nous. Néanmoins, la thèse de Darwin est que notre usage du langage diffère en degré, et non en nature, des systèmes de signes employés par d'autres animaux. Notre langage, pensait-il, n'est probablement qu'une extension naturelle d'un tel système primitif :
Je ne puis douter que le langage trouve son origine dans l'imitation et la modification des divers sons naturels, des voix d'autres animaux et des propres cris instinctifs de l'homme, avec l'appui de signes et de gestes (...) sur la base d'une analogie très étendue, nous pourrions en conclure que ce pouvoir se serait tout particulièrement exercé à l'occasion de la cour entre les sexes - qu'il aurait exprimé diverses émotions telles que l'amour, la jalousie, le triomphe - et qu'il aurait servi à défier ses rivaux. Il est probable donc que l'imitation des cris musicaux au moyen de sons articulés a donné naissance à des mots exprimant diverses émotions complexes (...) n'est-il pas possible qu'un singe exceptionnellement sagace ait imité le grognement d'une bête de proie et qu'il ait ainsi prévenu ses camarades singes de la nature du danger à attendre ? Ceci aurait été un premier pas dans la formation du langage [7].
Si Darwin pensait pouvoir expliquer le langage de cette façon, il doutait aussi de son importance. Même si les autres animaux n'ont pas un langage aussi impressionnant que l'homme, cela ne les empêche pas d'être rationnels. Dans un de ses premiers carnets, Darwin se donnait à lui-même la consigne suivante : « Oublie l'usage du langage et ne juge que par ce que tu vois [8] ». Quand nous observons le comportement des animaux non humains, il semble exhiber la raison, que le langage intervienne ou non :
L'orang-outan dans les îles orientales et le chimpanzé en Afrique construisent des plate-formes sur lesquelles ils dorment ; et comme les deux espèces suivent la même coutume, on pourrait soutenir qu'elle est due à l'instinct, mais nous ne saurions être certains qu'elle ne résulte pas du fait que les deux animaux ont les mêmes besoins et possèdent des capacités de raisonnement similaires [9].
De nos jours, nous pourrions exprimer la même idée en des termes quelque peu différents : notre meilleure théorie du comportement animal nous amène à leur attribuer des désirs et des croyances. Pris ensemble, les désirs et croyances constituent les raisons de l'action. Ainsi, lorsque nous expliquons de la sorte le comportement d'un animal (il recherche certains avantages et il prend conscience qu'il peut les obtenir en construisant une plate-forme etc.) nous considérons sa conduite comme rationnelle.
Mon propos n'est pas de défendre, ni même de discuter en détail, les idées spécifiques de Darwin concernant le langage ou la rationalité. Mais je veux attirer l'attention sur les implications morales de cette façon de penser. La stratégie d'argumentation de Darwin l'amène à entrer en conflit direct avec l'éthique traditionnelle, qui soutient que les humains et les non-humains appartiennent à des catégories morales séparées. Le point de vue de l'éthique traditionnelle est exprimé par un autre penseur du dix-neuvième siècle, le jésuite Joseph Rickaby, quand il écrit que nous n'avons pas de devoirs envers les simples animaux parce qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie des êtres envers lesquels nous pourrions avoir des devoirs. « Les bêtes (...) appartiennent à l'ordre des choses (...) Par conséquent, nous n'avons pas de devoirs de charité, ni de devoirs d'aucune sorte envers les animaux inférieurs, de même que nous n'en avons pas envers les bâtons et les pierres [10]. » Cependant, Darwin n'aurait jamais pu considérer les animaux non humains comme de simples choses. Sa stratégie le conduit à chaque instant à souligner leurs ressemblances avec les êtres humains. Il va même jusqu'à affirmer : « Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales [11]. » (Il admettait qu'il y avait des différences de degré, mais soulignait qu'elles étaient seulement une question de degré.) Mais si l'homme et l'animal sont tellement semblables, comment peut-il être juste de les traiter si différemment ? Comment peut-il être juste de les placer dans des catégories morales différentes ? Pourquoi ne faudrait-il pas que ces mêmes règles morales qui déterminent comment nous devrions être traités déterminent aussi comment ils devraient l'être ?
Il se peut que Darwin lui-même ait eu conscience de cette implication. Ses sentiments personnels au sujet des mauvais traitements envers les animaux étaient d'une intensité peu commune, et rejoignaient d'une certaine façon ses sentiments sur les mauvais traitements envers les humains. À propos du caractère de son père, l'un des fils de Darwin écrivait : « Les deux sujets qui émouvaient mon père peut être plus fortement que toute autre question étaient la cruauté envers les animaux et l'esclavage. Tous deux lui inspiraient une horreur intense, et son indignation était accablante si on faisait preuve de légèreté ou d'indifférence en la matière [12]. » Il est surprenant qu'un scientifique - et tout particulièrement un naturaliste qui avait tué d'innombrables animaux - ait eu de tels sentiments au sujet de la cruauté envers les bêtes. Qu'en est-il de l'utilisation des animaux pour la recherche ? Darwin écrivit dans une lettre,
Vous me demandez mon opinion sur la vivisection. J'admets tout à fait qu'elle est justifiable pour de réelles recherches sur la physiologie ; mais pas simplement pour une maudite et détestable curiosité. C'est un sujet qui me rend malade d'horreur, c'est pourquoi je n'ajouterai plus un mot là dessus, sans quoi je ne dormirai pas cette nuit [13].
Ce serait une erreur de compter Darwin parmi les défenseurs des « droits des animaux » ; ses sentiments étaient beaucoup trop ambigus pour cela. La vivisection le rendait malade - et ceux qui fréquentaient la maison Darwin se voyaient parfois interdire d'aborder le sujet - mais il l'estimait par ailleurs justifiable « pour de réelles recherches. » Il lui arriva une fois de soutenir une action visant à instaurer des contrôles législatifs sur l'usage des animaux dans la recherche, mais par la suite il refusa de soutenir une autre action dans ce sens [14]. Malgré ces hésitations, il semble pourtant clair qu'il était troublé par l'attitude dominante envers les animaux.
Darwin semble avoir fait le lien entre ses sentiments concernant les animaux et son approche biologique plus générale relative à la parenté des espèces (encore que je ne veuille pas me montrer trop affirmatif sur ce point). On trouve des indices d'un tel lien dans un passage comme celui-ci, extrait d'un de ses premiers carnets de notes :
Si nous laissons libre cours à nos conjectures, alors les animaux, nos frères semblables dans la douleur, la maladie, la souffrance et la famine, nos esclaves pour les travaux les plus pénibles, nos compagnons dans nos divertissements, les animaux donc, pourraient partager notre origine à travers un ancêtre commun, et il se pourrait que nous soyons tous les mailles d'un même filet [15].
Si Darwin faisait preuve d'ambiguïté, ce n'était pas le cas de certains de ses proches. Asa Gray, le professeur de botanique de Harvard qui fut l'ami et le défenseur de Darwin en Amérique, rendit explicite le lien entre biologie et éthique. Dans une conférence à la Yale Theological School prononcée moins de dix ans après la publication de The Descent of Man, il déclara :
Nous participons non seulement de la vie animale mais aussi de la vie végétale ; nous partageons avec les animaux supérieurs des instincts, sentiments et affections communs. Il me semble qu'il y a une sorte de bassesse à vouloir ignorer ce lien. Je pense que les êtres humains seront peut-être plus humains quand ils prendront conscience que leurs compagnons subordonnés vivent une vie dont participe la vie humaine, de sorte qu'ils ont des droits que l'homme est tenu de respecter [16].
III
Asa Gray posa la question morale fondamentale : est-ce que l'appartenance d'un être à une certaine espèce constitue en soi une raison moralement valable pour le traiter d'une certaine façon ? Le fait qu'un être soit humain est-il une raison pour le traiter avec plus de considération qu'on n'en accorde aux membres d'autres espèces ? Il y a au moins trois réponses possibles.
1. Le Spécisme Absolu. Tout d'abord, on peut vouloir défendre l'idée que la simple appartenance d'espèce est en soi moralement importante. Selon ce point de vue, le fait qu'un individu soit membre d'une certaine espèce, indépendamment de toute autre considération, suffit pour établir une différence quand à la manière dont cet individu devrait être traité.
Ce n'est pas là une manière très plausible d'interpréter la relation entre espèce et éthique, et elle n'est généralement pas acceptée même par les sympathisants de ce que j'appelle la « morale traditionnelle ». Prenons, par exemple, la vieille histoire de science fiction d'Eando Binder, « Le professeur venu de Mars [17] ». Le personnage principal est un Martien venu sur terre pour enseigner dans une école de garçons. Parce qu'il est « différent » - plus de deux mètres de haut, maigre, avec des tentacules et une peau à l'aspect de cuir - il est tourné en dérision et maltraité par les élèves au point d'être pratiquement chassé. C'est alors cependant qu'un acte d'héroïsme fait comprendre aux garçons leur tort ; l'histoire finit bien, le meneur responsable des brimades promettant de corriger sa conduite.
Écrite en 1941, cette histoire est une fable morale à peine déguisée sur le racisme. Le propos explicite, cependant, concerne l'espèce et non la race [18]. Le professeur venu de Mars est dépeint comme tout à fait identique, sur le plan psychologique, à un humain. Il est tout aussi intelligent et tout aussi sensible, avec les mêmes soucis et les mêmes intérêts que n'importe qui d'autre. Il ne se distingue que par un corps de genre différent. Et cela, assurément, ne justifie pas qu'on le traite avec moins de respect. Ayant admis ce point, le lecteur est ensuite censé en tirer cette conclusion évidente : l'existence de différences physiques entre les Blancs et les Noirs - la couleur de la peau, par exemple - ne devrait pas elle non plus entraîner de différence morale.
Certains philosophes ont néanmoins suggéré que la simple appartenance d'espèce pourrait impliquer une différence quant à nos devoirs moraux envers un être. Dans son commentaire du Case for Animal Rights de Tom Regan [19], Roberts Nozick avance l'hypothèse selon laquelle dans un schéma moral satisfaisant,
(...) il s'avérera peut-être que la simple appartenance d'espèce, le simple fait d'être un humain (...) doive impliquer un devoir de respect particulier de la part des seuls autres humains - ceci comme cas particulier du principe général selon lequel les membres d'une espèce peuvent légitimement accorder plus de poids à leurs semblables qu'ils n'en accordent aux membres d'autres espèces (ou du moins plus de poids que ne leur concéderait l'adoption d'une position neutre). Si les lions étaient des agents moraux, on ne pourrait les blâmer eux non plus pour avoir placé les autres lions au premier rang [20].
Nozick illustre cette idée par son propre exemple de science fiction : « les habitants d'Alpha du Centaure » pourraient légitimement accorder plus de poids aux intérêts d'autres Alpha-Centauriens qu'ils n'en accordent aux nôtres, même si nous leur étions semblables à tout autre point de vue pertinent. Mais cette affirmation n'a rien d'évident - bien au contraire, en fait. Si dans l'histoire de Binder nous remplaçons le Martien par un Alpha-Centaurien, nous n'avons rien changé. Le traiter moins bien parce qu'il est « différent » (dans ce cas, membre d'une espèce différente) paraît toujours une discrimination arbitraire.
Qu'en est-il du « principe général » suggéré par Nozick ? Il semble être une version étendue d'une idée que la plupart des gens trouvent plausible, à savoir qu'il est justifié d'accorder un poids spécial aux intérêts de sa famille ou de ses voisins. S'il est permis d'avoir une attention spéciale pour sa famille ou ses voisins, pourquoi ne le serait-il pas pour les membres de sa propre espèce ? Le problème que pose cette façon de voir vient de ce que nous appartenons naturellement à une multitude de groupes, et que cette appartenance de groupe n'est pas toujours (si tant est qu'elle le soit jamais) moralement significative. La progression qui va de la famille au voisin puis à l'espèce traverse d'autres frontières en chemin - la frontière de race, par exemple. Supposons que quelqu'un suggère qu'il est légitime d'accorder plus de poids aux intérêts de notre race qu'à ceux des autres ? ( « On ne pourrait blâmer non plus les Noirs, dirait-on, pour avoir placé les autres Noirs au premier rang. ») Une telle idée se verrait repousser, avec raison ; cependant, les distinctions fondées uniquement sur l'appartenance d'espèce ne paraissent guère mieux fondées. Comme le suggère l'histoire de Binder, le Spécisme Absolu et le racisme sont des doctrines jumelles.
2. Le Spécisme Conditionné. Il existe une approche plus sophistiquée de la relation entre éthique et espèce, et c'est elle qu'adoptent le plus souvent les défenseurs de la morale traditionnelle. Selon cette approche, l'espèce n'est pas considérée comme moralement significative en elle-même. Toutefois, l'appartenance d'espèce est corrélée à d'autresdifférencesqui, elles, sont significatives. Les humains, pourrait-on dire, sont dans une catégorie morale spéciale parce que ce sont des agents rationnels et autonomes. (D'autres qualités spécifiquement humaines sont parfois mentionnées, mais, au moins depuis Kant, c'est celle-ci qui a eu le plus de succès.) C'est ce trait, plutôt que le « simple » fait d'être humains, qui leur vaut de mériter une considération spéciale. C'est à cause de cela que leurs intérêts sont plus importants, moralement parlant, que ceux d'autres espèces, bien que l'on puisse supposer que si les membres de quelque autre espèce étaient eux aussi des agents rationnels et autonomes, ils appartiendraient eux aussi à cette catégorie morale spéciale, puisque possédant les qualités requises pour bénéficier du traitement de faveur. Toutefois, les défenseurs de la morale traditionnelle soulignent que, de fait, aucune autre espèce ne présente ces caractéristiques. Par conséquent, seuls les humains ont droit à une pleine considération morale.
Darwin, on l'a vu, doutait que les humains présentent des caractères non partagés par les autres animaux. Au contraire, il mit l'accent sur la continuité entre les espèces : si l'homme est plus rationnel que les singes, c'est seulement une question de degré et non de nature. Mais laissons ce point de côté, et admettons pour les besoins de l'argumentation que les humains sont les seuls agents pleinement rationnels et autonomes. Que découlerait-il de cette hypothèse ? Je voudrais faire deux remarques.
(a) La première a trait à la structure logique du Spécisme Conditionné. Il importe de voir quel rôle exact est censée jouer la référence à la rationalité humaine. Celle-ci intervient à un certain point de la discussion sur l'éthique et l'espèce, et vise un certain but. Voyons quel est ce but.
La discussion part de l'observation selon laquelle nous utilisons les animaux non humains de diverses manières : pour en citer quelques unes, nous les élevons pour les manger ; nous les utilisons dans les laboratoires, non seulement pour des expériences médicales et physiologiques, mais aussi pour tester des produits tels que le savon et les cosmétiques ; nous les disséquons dans les lycées dans un but pédagogique ; nous utilisons leur peau pour faire des vêtements et des couvertures et pour décorer nos murs ; nous en faisons des objets de divertissement dans les zoos, les cirques et les rodéos ; nous les faisons travailler dans les fermes ; nous les gardons comme animaux de compagnie ; et nous avons un sport populaire consistant à les traquer et à les tuer juste pour le plaisir.
On remarque ensuite que si des humains étaient utilisés de la sorte, nous trouverions cela profondément immoral. Mais ceci soulève un problème. Depuis Aristote, on a reconnu comme une des règles fondamentales du raisonnement moral la proposition suivante :
Quand des individus sont traités de façon différente, on doit pouvoir désigner une différence entre eux qui justifie cette différence de traitement.
Nous voilà ainsi confrontés à cette question : quelle est la différence entre les humains et les non-humains qui nous autorise à traiter ces derniers de façon si différente ?
C'est ici qu'entre en jeu la référence à la rationalité. Le Spécisme Conditionné tente de répondre à cette question en soulignant le caractère d'agents rationnels autonomes des humains, en contraste avec les autres animaux - telle est la différence qui est censée justifier le traitement différent des non-humains.
Mais maintenant, notez ce point crucial : nous traitons les non-humains de diverses manières dont nous pensons qu'il serait mal de traiter les humains. Dans sa tentative pour justifier cela, le Spécisme Conditionné mentionne une différence entre les humains et les non-humains. Ce raisonnement peut-il fonctionner ? Le fait que les humains soient rationnels, et que les autres animaux ne le soient pas, est-il pertinent pour justifier toutes les différences de traitement ?
De façon générale, les différences qui sont pertinentes varient selon le type de traitement. Une différence entre individus justifiant une sorte de différence de traitement peut être totalement inadéquate pour en justifier une autre. Supposons par exemple que la commission de sélection d'une faculté de droit accepte un candidat et en rejette un autre. Si nous leur demandions de justifier leur choix, les membres de la commission pourraient expliquer que le premier candidat était très bien classé au lycée et avait d'excellents résultats aux tests, tandis que les scores du second étaient lamentables. Ou, pour prendre un autre type d'exemple, supposons qu'un médecin traite deux patients différemment : il fait une piqûre de pénicilline à l'un et met le bras de l'autre dans le plâtre. Là encore, cela peut être justifié en invoquant les différences significatives entre eux : le premier patient souffrait d'une infection tandis que le second avait le bras cassé.
Maintenant, imaginons que l'on permute les choses. Supposons qu'on demande à la commission de sélection de la faculté de droit de justifier l'admission de A et le rejet de B, et qu'elle réponde que A avait une infection tandis que B avait un bras cassé. Ou supposons qu'on demande au médecin de justifier la piqûre de pénicilline pour A et le plâtrage du bras pour B et qu'il réponde que A était mieux classé au lycée et avait de meilleurs résultats aux tests. Bien sûr, les deux réponses sont idiotes, car il est clair que ce qui est pertinent dans un cas ne l'est pas dans l'autre.
Nous pouvons exprimer ceci sous la forme d'un principe général :
La question de savoir si une différence entre des individus justifie une différence de traitement dépend de la nature du traitement en cause. Une différence justifiant une sorte de différence de traitement n'en justifie pas nécessairement une autre.
Une fois explicité, ce principe semble évident et indiscutable. Mais une fois qu'il est accepté, il apparaît que le Spécisme Conditionné est insoutenable.
Le fait que quelqu'un soit un agent rationnel et autonome implique-t-il une différence quant à la manière dont il devrait être traité ? Assurément, il peut en être ainsi. Pour un tel être, maîtriser la direction de sa propre vie est un grand avantage, apprécié non seulement pour sa valeur instrumentale mais aussi en lui-même. Par conséquent, l'intervention paternaliste peut être considérée comme un mal. Pour prendre un exemple simple, une femme peut avoir une certaine conception de la manière dont elle veut vivre sa vie. Cette conception peut impliquer de courir des risques que nous jugeons insensés. Aussi pourrions-nous essayer de la faire changer d'avis ; nous pourrions attirer son attention sur les risques et soutenir qu'il ne vaut pas la peine de s'y exposer. Mais supposons qu'elle n'accepte pas nos arguments : avons-nous alors le droit de l'empêcher par la force de vivre sa vie comme elle l'entend ? On pourrait soutenir que non, car il s'agit, après tout, d'un agent rationnel et autonome. Voyons au contraire comment nous pourrions traiter quelqu'un qui n'est pas un être pleinement rationnel - un jeune enfant, par exemple. Nous nous sentons alors parfaitement autorisés à nous mêler de sa conduite, pour l'empêcher de prendre des risques insensés. Le fait que l'enfant ne soit pas (du moins, pas encore) un être pleinement rationnel justifie que nous le traitions autrement que nous traiterions quelqu'un qui le serait.
Il en irait de même si la comparaison portait sur un humain (normal et adulte) et un animal non humain. Si nous intervenons de force pour protéger l'animal d'un danger, sans en faire autant pour l'humain, nous pouvons nous justifier en soulignant que l'humain est un être rationnel et autonome, qui savait ce qu'il faisait et qui avait le droit de faire son propre choix, ce qui n'était pas le cas de l'animal. Mais cette différence n'est pas pertinente pour justifier n'importe quelle sorte de différence de traitement. Supposons qu'il s'agisse non pas d'intervention paternaliste, mais de mettre des produits chimiques dans les yeux des lapins pour tester la « sécurité » d'un nouveau shampoing. Pourquoi, pourrait-on demander, serait-il bien de traiter les lapins de cette façon alors que nous ne traiterions pas les humains de la sorte ? Répondre que les humains sont des agents rationnels, alors que les lapins ne le sont pas, est comme constater que le candidat refusé par la faculté de droit avait un bras cassé plutôt qu'une infection.
Par conséquent, le caractère d'agents rationnels des humains ne peut pas justifier la série complète des différences dans notre traitement des humains et des non-humains. Il peut (au mieux) en justifier certaines mais pas d'autres. Ainsi, dans sa prétention à justifier notre pratique générale consistant à traiter « différemment » les non-humains, le Spécisme Conditionné échoue.
On pourrait penser pouvoir sauver le Spécisme Conditionné en mentionnant un plus grand nombre de différences entre humains et non-humains. Rickaby, par exemple, souligne que « seul l'homme parle, seul l'homme adore Dieu, seul l'homme espère le contempler pour l'éternité », et ainsi de suite [21]. Ne se pourrait-il pas qu'une combinaison de tels caractères uniques justifie de placer l'homme dans une catégorie morale spéciale ? Le problème logique demeurerait néanmoins entier : nous devrions nous demander, pour chaque sorte de traitement, si la capacité de l'homme à parler, à adorer Dieu, ou à espérer la contemplation éternelle est réellement pertinente. Quel rapport cela a-t-il avec le fait de mettre des produits chimiques dans les yeux des lapins ? De même qu'il n'y a pas une différence entre les espèces susceptible de justifier à elle seule toutes les différences de traitement, il n'y a pas non plus de raison de penser qu'une liste de telles différences pourrait faire l'affaire.
(b) Un autre type de problème est celui soulevé par les humains à qui les caractères censés placer l'homme dans une position morale privilégiée font défaut. Le Spécisme Conditionné nous dit que les intérêts des humains comptent davantage parce que ce sont des agents rationnels. Mais certains humains, suite par exemple à des lésions cérébrales, ne sont pas des agents rationnels. Ceci étant admis, il serait naturel d'en conclure que leur statut est celui de simples animaux et qu'on peut les utiliser comme on utilise les non-humains (par exemple, comme sujets d'expériences, comme nourriture...).
Bien sûr, les moralistes traditionnels n'acceptent pas une telle conclusion. Les intérêts des humains sont considérés comme importants quels que soient les « handicaps » dont ils sont affectés. Pour la conception traditionnelle, semble-t-il, le statut moral est déterminé par la norme pour l'espèce. Donc, parce que chez les humains la rationalité est la norme, même ceux qui ne sont pas rationnels doivent être traités avec ce même respect dû aux membres d'une espèce rationnelle.
Cette idée - à savoir que la manière dont les individus devraient être traités est déterminée par la norme pour leur espèce - présente un certain attrait, parce qu'elle semble exprimer notre intuition morale relative aux humains déficients. « Nous ne devrions pas traiter une personne plus mal simplement parce qu'elle a eu si peu de chance » pourrions-nous dire à propos de la victime d'une lésion cérébrale. Mais l'idée ne résistera pas à un examen minutieux. Imaginons (ce qui est probablement impossible) qu'un chimpanzé ait appris à lire et parler l'anglais. Et supposons qu'il finisse par acquérir la faculté de discuter de science, de littérature et de morale. Suite à quoi, il demande à s'inscrire à l'université. Plusieurs arguments pourraient être avancés sur cette question, mais supposons que quelqu'un raisonne comme suit : « Seuls les humains doivent être autorisés à s'inscrire à l'université. En effet, les humains peuvent lire, parler et comprendre les sciences. Les chimpanzés ne le peuvent pas. » Mais ce chimpanzé est capable de faire tout cela. « Oui, mais les chimpanzés normaux ne le sont pas, et c'est cela qui importe. » Un tel argument est-il valable ? Indépendamment de la validité éventuelle des autres arguments pour ou contre l'inscription, celui-ci est faible. Il suppose que nous devrions déterminer la manière dont un individu doit être traité non pas sur la base de ses propres qualités mais sur la base des qualités d'autres individus. Le chimpanzé n'est pas autorisé à faire quelque chose qui demande de savoir lire, bien qu'il puisse le faire, parce que les autres chimpanzés ne le peuvent pas. Cela semble non seulement injuste, mais irrationnel.
3. L'Individualisme Moral. Tout ceci plaide en faveur d'une approche complètement différente, une approche qui renoncerait totalement à la tentative de justifier une « catégorie morale séparée » pour les humains. Selon cette approche, la façon dont un individu doit être traité est déterminée, non pas en considérant son appartenance de groupe, mais en considérant ses propres caractères particuliers. Si A doit être traité différemment de B, la justification doit reposer sur les caractéristiques individuelles de A et sur les caractéristiques individuelles de B. On ne peut justifier de les traiter différemment en faisant valoir que l'un ou l'autre est membre d'un groupe privilégié.
Où cela nous conduit-il la relation entre espèce et éthique ? Qu'en est-il des importantes différences entre les humains et les autres animaux ? Faut-il maintenant les considérer comme non pertinentes ? Le tableau qui se dessine est plus complexe, mais aussi plus conforme aux faits, que celui que dresse la morale traditionnelle. Le fait est que les êtres humains ne sont pas simplement « différents » des autres animaux. En réalité, il y a une trame complexe de similitudes et de différences. La position morale correspondante est que, dans la mesure où un humain et un membre d'une autre espèce sont semblables, ils devraient être traités semblablement, tandis que dans la mesure où ils sont différents, ils devraient être traités différemment. Ceci autorisera l'humain à faire valoir son droit à un meilleur traitement chaque fois qu'il y a une différence entre lui et d'autres animaux (ou d'autres humains !) justifiant qu'on le traite mieux. Mais ceci ne l'autorisera pas à revendiquer des droits supérieurs simplement parce qu'il est humain, ou parce que les humains en général ont telle ou telle qualité qui à lui fait défaut, ou parce qu'il présente une caractéristique qui n'a aucun rapport avec le traitement en question.
Il existe un parallélisme frappant entre cet Individualisme Moral et la conception darwinienne de la nature de l'espèce. Avant Darwin, quand on croyait les espèces immuables, les naturalistes pensaient que l'appartenance à une espèce était déterminée par le fait qu'un organisme possède les qualités définissant l'essence de cette espèce. Cette essence était quelque chose de réel et de déterminé, fixé par la nature elle-même, et les systèmes de classification imaginés par les biologistes étaient jugés corrects ou défectueux selon leur degré d'adéquation à cet ordre naturel fixe. La biologie évolutionniste implique une conception très différente. Darwin soutenait qu'il n'y avait pas d'essences fixes ; il y a seulement une multitude d'organismes qui se ressemblent à certains égards mais diffèrent à d'autres. La seule réalité est l'individu [22]. La façon dont les individus sont regroupés - en espèces, variétés etc. - est plus ou moins arbitraire. Dans L'origine des espèces, Darwin écrivait :
Je considère le terme d'espèce comme un nom donné arbitrairement pour des raisons de commodité à une série d'individus se ressemblant étroitement ; et il ne diffère pas essentiellement du terme de variété, qui est donné à des formes moins distinctes et plus fluctuantes. Le terme de variété, à son tour, par rapport à de simples différences individuelles, est aussi appliqué arbitrairement, pour de simples raisons de commodité [23].
Ainsi, la biologie darwinienne substitue les organismes individuels, avec leur profusion de similitudes et de différences, à la vieille idée d'espèces déterminées ; tandis que l'Individualisme Moral substitue la conception selon laquelle notre traitement de ces organismes individuels doit être sensible à ces similitudes et différences, à l'ancienne conception selon laquelle ce qui importe est l'espèce à laquelle l'organisme appartient.
IV
Comment « l'illumination progressive de l'esprit des hommes, » telle qu'elle peut résulter de la théorie darwinienne, conduit-elle au rejet du spécisme ? On peut imaginer un processus historique comportant quatre étapes.
À la première étape, la morale traditionnelle est confortablement acceptée parce qu'elle est soutenue par une vision du monde unanimement partagée (ou partagée de façon si quasiment unanime que cela revient au même). La conception de la morale est simple. Les êtres humains, comme l'exprime Kant, ont « une valeur intrinsèque, à savoir la dignité », qui leur confère une valeur « inestimable » ; tandis que les autres animaux « (...) ne sont là qu'en tant des moyens pour une fin. Cette fin est l'homme [24]. » La vision du monde qui soutenait cette doctrine morale comportait plusieurs éléments familiers : L'univers, avec la terre en son centre, était conçu comme créé par Dieu principalement pour abriter les humains, lesquels étaient façonnés à son image. Les autres animaux avaient été créés par Dieu pour leur usage. Les humains, par conséquent, sont séparés des autres animaux et possèdent une nature radicalement différente. C'est cela qui justifie leur statut moral spécial.
À une seconde étape, cette vision du monde commence à se désagréger. Ce processus avait débuté, bien sûr, longtemps avant Darwin - on savait déjà, par exemple, que la terre n'est pas au centre de l'univers, et qu'en tant que corps céleste elle semble en vérité n'avoir rien de spécial. Mais Darwin acheva le travail en montrant que les humains, loin d'être séparés des autres animaux, font partie du même ordre naturel, voire en sont en fait de très proches parents. Quand Darwin eut terminé son œuvre, l'ancienne vision du monde était virtuellement en ruines.
Cependant, cela ne signifie pas que la conception morale qui lui était associée allait être immédiatement abandonnée. Les doctrines morales fermement établies ne lâchent pas prise en une nuit, parfois pas même en un siècle. Comme l'a observé Peter Singer, « Si une position idéologique se trouve brusquement privée de ses fondements, on lui en trouvera d'autres, ou alors, elle restera simplement suspendue en l'air, défiant l'équivalent dans le domaine logique des lois de la pesanteur [25]. »
Nous en sommes maintenant à la troisième étape, qui s'ouvre lorsque les gens réalisent qu'ayant perdu ses fondements, l'ancienne conception morale doit être révisée. Dans le compte-rendu qu'il fait du livre de Regan, Nozick remarque qu' « on ne peut rien déduire du fait que nous manquons actuellement d'une théorie de l'importance morale de l'appartenance d'espèce, à la formulation de laquelle personne n'a consacré beaucoup de temps parce que la question n'a pas semblé urgente [26]. » La question n'a pas semblé urgente parce que les philosophes n'ont pas pleinement assimilé les conséquences de l'effondrement de l'ancienne conception du monde.
La morale traditionnelle pourrait encore s'avérer défendable, si on parvient à lui trouver de nouvelles bases. Nozick, et une foule d'autres avec lui, pensent que c'est probable. Des philosophes comme Singer et Regan adoptent une position différente : « l'illumination progressive de l'esprit des hommes » doit conduire à une nouvelle éthique, dans laquelle l'appartenance d'espèce est considérée comme relativement secondaire. Pour les raisons avancées plus haut, je pense que sur ce vaste sujet les partisans d'une révision sont dans le vrai. La position la plus défendable semble être quelque forme d'Individualisme Moral, pour laquelle ce sont les caractéristiques individuelles des organismes qui importent, et non pas les classes auxquelles on les affecte. Quelle que soit l'issue du débat, la question ne peut plus être évitée. Ce n'est pas simplement l'intérêt lunatique de quelques philosophes pour le bien-être animal qui l'a rendue « urgente », mais plutôt la désintégration de la conception pré-darwinienne de la nature. La quatrième et dernière étape du processus historique sera atteinte si nous trouvons un nouvel équilibre dans lequel notre éthique puisse de nouveau cohabiter confortablement avec notre compréhension du monde et de la place que nous y occupons.
[1] Cité dans Ronald W. Clark, The Survival of Charles Darwin: A Biography of a Man and an Idea, éd. Random House, New York, 1984, p. 178, à partir du carnet de notes « C » des manuscrits de Darwin conservés à la Cambridge University Library. Ladite biographie constitue un excellent recueil d'informations sur divers sujets relatifs à Darwin.
[2] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, traduction française P. Klossowski, éd. Gallimard (coll. Idées), 1961, thèse 4.1122.
[3] Lettre à Lassalle, 16 janvier 1861 ; extrait cité par Clark, p. 212.
[4] Voir Anthony Flew, Evolutionary Ethics, éd. Macmillan, Londres, 1967, p. 5.
[5] Cité par Erhard Lucas, « Marx and Engels: Auseinandersetzung mit Darwin zur Differenz zwischen Marx und Engels » dans International Review of Social History, vol 9 (1964) p. 433-469. La citation est extraite d'une lettre de Darwin considérée comme adressée à Marx. On a cependant aujourd'hui des raisons de croire que la lettre était en réalité destinée au gendre de Marx, Edward Aveling.
[*] Voir à ce sujet le chapitre 3, « Must a Darwinian be Sceptical about Religion ? », de l'ouvrage de James Rachels Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism, éd. Oxford University Press, Oxford, New York, 1991 (NdT).
[6] Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, éd. John Murray, Londres, 1859, p. 488.
[7] Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, éd Random House Modern Library Edition, New York, p. 463.
[8] « Darwin's Early and Unpublished Notebooks », dans Howard E. Gruber, Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity, Londres, 1974, p. 296.
[9] The Descent of Man, p. 446.
[10] Joseph Rickaby, S.J., Moral Philosophy, Londres, 1882, repris dans Animal Rights and Human Obligations, ouvrage collectif sous la direction de Tom Regan et Peter Singer, éd. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1976, p. 179. Pour des auteurs comme Saint Thomas d'Aquin, Descartes, Kant et Rickaby, les prétendus intérêts de non humains ne comptent pour rien, moralement parlant ; s'il est parfois mauvais de les « maltraiter » c'est uniquement parce que les intérêts des humains sont impliqués en quelque manière. Il existe un autre point de vue, moins radical, adopté par la plupart des défenseurs contemporains de la morale traditionnelle, à savoir que même si les intérêts des non humains comptent pour quelque chose, ils comptent beaucoup moins que les intérêts des humains. Dans le présent contexte, cette différence est sans importance : les arguments avancés ici s'appliquent également aux deux points de vue.
[11] The Descent of Man, p. 446.
[12] Cité dans Clark p. 76. Pour d'autres informations sur l'attitude de Darwin envers les animaux, voir Clark p. 76-77.
[13] Lettre à Ray Lankester du 22 mars 1871, dans Francis Darwin, La vie et les lettres de Charles Darwin, éd. John Murray, Londres, 1887, volume III, p. 200.
[14] Voir The Collected Papers of Charles Darwin rassemblés par Paul H. Barrett, éd. University of Chicago Press, Chicago, 1977, vol. II, p. 226.
[15] Carnet « B » de Darwin, conservé parmi les documents de Darwin à la Cambridge University Library, p. 121, cité par Clark, p. 76.
[16] Asa Gray, Natural Science and Religion: Two Lectures Delivered to the Theological School of Yale College, éd. Charles Scribner's Sons, New York, 1880, p. 54. La position de Gray contraste nettement avec celle d'un autre champion de Darwin, T.H. Huxley. En réponse à l'accusation selon laquelle Darwin minait la dignité humaine, Huxley déclara : « (...) personne n'est plus convaincu que moi de l'immensité du gouffre qui sépare l'homme civilisé des bêtes (...) le fait de savoir que l'homme, en substance et en structure, ne fait qu'un avec les bêtes n'amenuisera pas notre respect pour la noblesse de l'humanité. » T.H. Huxley, Evidence as to Man's Place in Nature, éd. Williams and Norgate, Londres, 1863, chap. 2. Darwin, qui était en contact étroit avec les deux hommes, devait être conscient de la différence de leurs positions quant aux implications morales de sa théorie. Mais nous ignorons ce qu'il a tiré lui-même de ce constat.
[17] Cette histoire est reprise dans le recueil My Best Science Fiction Story de Leo Marguiles et Oscar J. Friend, éd. Pocket Books, New York, 1954.
[18] Il y a là un retournement intéressant : de nos jours, des auteurs comme Singer tiennent pour acquis que le racisme est mauvais, et soutiennent par analogie que le spécisme l'est aussi ; tandis qu'en 1941 Binder tenait pour évident que le spécisme était mauvais, et espérait que ses lecteurs comprendraient que le racisme était mauvais. Voir Peter Singer, La libération animale, éd. Grasset, Paris 1993, chap. 1.
[19] Tom Regan, The Case for Animal Rights, éd. University of California Press, Berkeley, 1983.
[20] Robert Nozick « About Mammals and People », The New York Times Book Review, 27 novembre 1983, p. 29. Pour une discussion plus approfondie des arguments de Nozick, voir mon The End of Life: Euthanasia and Morality, Oxford University press, Oxford, 1986, chap. 4.
[21] Rickaby, cité plus haut dans la note 10.
[22] Pour les naturalistes pré-darwiniens, les variations présentaient peu d'intérêt, sauf à titre de curiosités. Après tout, c'était le spécimen « étalon » qui représentait le mieux l'essence éternelle de l'espèce, que le naturaliste essayait de comprendre. Mais pour le biologiste évolutionniste, la variation est le véritable matériau de la nature - c'est elle qui rend la sélection naturelle possible.
[23] The Origin of Species, p. 52. Pour une défense récente de l'idée qu'il y a plusieurs manières également valables d'identifier les espèces, chacune répondant à un besoin légitime différent des biologistes, voir Philippe Kitcher, « Species », Philosophy of Science, vol. 51, 1984, p. 308 à 333.
[24] Emmanuel Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals, traduit par White Beck, éd. Bobbs-Merril, Indiana, Indianapolis, 1959, p. 47 ; et Lectures on Ethics, traduit par Louis Infield, éd. Harper and Row, New York, 1963 p. 239-240.
[25] Singer, p. 319.
[26] Nozick, cité dans la note 20 ci-dessus.






 Une mine de ressources
Une mine de ressources